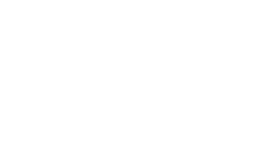Dorian Pimpernel au festival "L'Épopée Born Bad"à l'occasion des 10 ans du label Born Bad
Diffuseur
France Télévisions / Culturebox
Date
2017
Durée
3′
Réalisation
Christian Beuchet
Résumé
Que fait la pop aujourd’hui? Elle nous remplit la tête, elle nous élève. Elle invente chichement, elle pille un peu, elle recopie pas mal. Elle nous accompagne encore, elle nous martyrise parfois. Elle nous élève encore de temps en temps, elle nous euphorise encore. Elle nous dégoûte et elle nous rabaisse, aussi, souvent. Mais une chose qu’elle ne fait plus que très, très ponctuellement, c’est nous faire rêver, les yeux ouverts ou fermés. Le psychédélisme est au point mort, l’ecstasy ne fait plus effet sur personne, les grands espaces sont quadrillés du Far West jusqu’au Soleil Levant, les grands mélodistes pissent dans des violoncelles parce que plus personne n’est là pour les écouter. Quant aux magiciens de la chanson, les enfants des George Martin, David Vorhaus, Syd Barrett ou Don Van Vliet qui nous commandaient autrefois dans nos songes en utilisant potions, grimoires et miroirs, ils ont pris le maquis: si la pop music de la plus belle race qui soit – l’ésotérique – se pratique encore, c’est dans des laboratoires cachés et des
souterrains plus profondément enterrés encore que ceux du garage, du punk ou du metal noir.
Praticiens assidus de la part magique, cabalistique de la discipline pop depuis des années (on dirait des siècles), la société secrète Dorian Pimpernel ne semble oeuvrer que dans un but: remettre en marche la machine à songes et à extases. Formée vers le milieu des années 2000, elle ne rassemble que des cas: un batteur discret et “captivé par l’antiquité grecque”; un songwriter enseignant à l’occasion la philosophie et auteur d’un livre sur l’esthétique des Minimalistes d’Amérique; un réalisateur-acteur-assistant-réalisateur-compositeur de musiques de films (pour lui-même/et/ou en collaboration avec Serge Bozon ou Axelle Ropert, Mehdi Zannad, Pierre Léon…), que l’on peut souvent voir aux côtés de Barbara Carlotti; un acteur-bassiste et collectionneur de disques d’illustration sonore vraisemblablement dur à faire taire quand il a entamé la liste de ses artistes préférés (il prétend avoir “plus de souvenirs que s’il avait mille ans”); un porte-voix involontaire enfin, qui joua longtemps de sa guitare dans sa chambre “sans penser avoir un jour le cran d’en sortir”.
En marges des habitus et ambitions habituelles de “la bande de potes” qui “se met au rock” après avoir passé à discuter autour d’une poignée de disques préférés, ces cinq là se sont trouvés autour d’un inintérêt général pour le sport et un étrange concept de pop (au sens fort de concept, celui qu’approuverait un Gilles Deleuze qui se serait un peu plus intéressé à la musique): la “moonshine pop”, petite soeur ésotérique, logiquement lunatique voire maléfique de la fameuse “sunshine pop” de Californie. Initiateur du mouvement à une époque où il était seul membre du club Dorian Pimpernel, Johan explicite: “A l’époque, au milieu des années 2000, j’écoutais des disques de sunshine pop en boucle, et j’avais conçu de prendre cette notion à rebours, de tenter une esquisse de son envers, sans distance postmoderne ni ironie facile, sans revivalisme non plus. Il s’agissait avant tout d’une proposition moderne, qui ne soit pas une simple actualisation de l’ancien selon le parfum du jour, mais une manière de faire un monde en assemblant progressivement, brique après brique, les sonorités, les nuances et les intentions qui le peupleraient.”
Après un premier essai conçu en studio pour un label à l’autre bout du Monde (Hollandia, sorti sur le label japonais Rallye en 2006) qu’on jugera, avec le recul, plus embryonnaire, Allombon fait donc un monde, et souhaite vous y enfoncer la tête si profond que ce sont vos rêves et vos cauchemars qui auront la charge d’en accueillir les créatures, les mélopées, les architectures.
A la manière des grands livres mi-magiques, mi-littéraires de la Renaissance, mi-traités d’alchimie, mi-grimoires de poésie, Allombon fait même un monde si complexe et si cohérent que chaque chanson y est à la fois un fragment et un tout à déplier, à la fois autonome, potentiellement capable de nous le faire voir en entier et tragiquement lacunaire, poétiquement investi du sentiment d’être passé à côté des mondes qui se cachent à côté. Ensemble ou séparément, chacune des dix chansons méritera donc son exégèse, ses notes de bas de page, et toute votre attention (à titre indicatif, les exégètes volontaires trouveront ci-joint un petit guide de survie facultatif en monde pimpernelien rédigé par Johan).
Mais qu’on prévienne surtout l’auditeur qui se fiche des encyclopédies et préfère à visiter les labyrinthes sans plan: il a le droit strict d’avancer à l’aveugle, de se laisser intoxiquer les yeux fermés. Et si ce qu’il trouvera sur sa route est dense, non-linéaire, feuilleté, ce qu’il entendra en premier est surtout, mélodieux, merveilleux. Rappelons l’amorce de notre présentation: la répétition tenue, presque agressive, du mot pop.
Si nos cinq freaks sont les praticiens ténébreux d’une doctrine secrète, ils croient surtout au pouvoir fabuleux de la grande mélodie pop; si leur art est ésotérique, c’est à la manière d’Alice au pays des merveilles, c’est-à-dire en douceur et en couleurs. Inspirés en premier par la première vague de psychédélisme et les artefacts pensants de la pop savante des années 60 (Sgt Peppers, S.F. Sorrow des Pretty Things, An Electric Storm de White Noise, The United States of America de The United States of America), en deuxième par celle des années 70 (“construire des ponts entre Canterbury et Düsseldorf”, c’est-à-dire entre Kevin Ayers et Kraftwerk, est l’un de leurs projets avoués), en troisième par quelques grands noms plus ou moins connus de la musique d’illustration et de la musique de film de l’âge d’or des deux genres (Morricone, Basil Kirchin…), en quatrième enfin par les milliers d’instruments hantés (synthés rares ou très rares, vieilles guitares) qui peuplent leur studio en forme de cabinet de curiosités, les cinq de Dorian Pimpernel n’ont qu’un but avoué, faire naître des tornades pour nous emporter.
Instigateurs involontaires d’une sorte d’hantologie à la française (rappelons sommairement que dans sa version anglo-saxonne, l’hauntology de Grande-Bretagne recouvre, avec ses souvenirs de sorcières et de poussière, de Ballard et d’électronique archaïque, l’une des scènes les plus mystérieuses de notre temps musical), notre Club des Cinq ambitionne, pour citer Ludwig Wittgenstein à propos de ses travaux en architecture, de “parler, peut-être inconsciemment, la langue ancienne, mais de la parler de telle manière qu’elle appartienne au monde nouveau, sans pour autant appartenir nécessairement au goût de celui-ci”. Ce que Dorian Pimpernel propose, c’est, à l’instar des Britanniques de Broadcast avant eux, une musique passéïste seulement à la surface de sa surface, mais surtout fidèle à l’essence de son temps. Comprendre: ambigüe dans les sons comme dans les intentions (“le simulacre sonore qui se dénonce”), vibrionnante, clignotante, multiple; mais aussi, surtout, immédiate, harmonieuse, vénéneuse, diablement belle. La bonne nouvelle pour les pressés, c’est que ce deuxième album en forme de premier a d’ores et déjà la forme d’un “album de la maturité” dans ses thèmes (toutes les chansons parlent d’illusions perdues et de chemins qui ne mènent nulle part, pour citer deux écrivains) et d’un manifeste dans sa forme.
Olivier Lamm