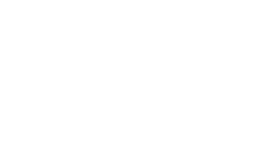Sister Iodine en interview
Diffuseur
Le Drone
Date
Novembre 2016
Durée
5′
Réalisation
Marc-Aurèle Baly
Résumé
Sister Iodine fait aujourd’hui à la fois figure de vétéran, de franc-tireur et de tête chercheuse de la scène noise française. Actif depuis le début des années 90, le groupe mené par Erik Minkkinen, Lionel Fernandez et Nicolas Mazet s’est toujours employé à creuser le même sillon de radicalité, tout en ne se départant pas d’un certain sens de la constance dans l’éclatement de formes et la recherche de matière sonore.
Mais c’est peut-être plus que jamais aujourd’hui que la trajectoire de Sister Iodine a profondément quelque chose de fascinant. De son premier album ADN 115 sorti en 1994 et fortement influencé par la no wave new-yorkaise historique (école Mars, DNA ou les Theoretical Girls de Glenn Branca), à leur dernière expression, incarnée par l’album Blame sorti en 2013, et infusée, comme le guitariste Lionel Fernandez le dit lui-même lorsqu’on le rencontre, par “différents poisons” tels que le black metal, la musique industrielle la plus abrasive ou des relents de power electronics brûlée, le groupe est passé des squats inhospitaliers du rock alternatif français des années 90 à une acceptation bien plus bienveillante vingt ans plus tard. Aujourd’hui, il peut se produire notamment au festival Red Bull Music Academy à la Gaîté Lyrique, devant un parterre mêlé de fans historiques et surtout de gens bien plus jeunes qu’eux (et c’est ce qui est assez inédit), s’abreuvant à la source qu’offre le groupe, faite d’ultra-violence, de radioactivité et de noirceur vénéneuse. Que s’est-il passé en près de vingt-cinq années pour que la musique du groupe change de destinataire et intéresse à ce point les générations les plus jeunes, celles pour qui la techno n’offre plus assez de soubresauts (tels que Powell, qui jouait ce soir-là juste après les Français), ou celles pour qui le rock est devenu une forme tellement archaïque que la bousculer reviendrait à en accepter encore et toujours la caducité ?
Déjà, il aura fallu que Sister Iodine traverse les époques, les modes et les tendances (en gros, la jonction 90-2000 que le groupe juge essentielle dans la compréhension et la digestion de la folie électronique de l’époque), tandis que la plupart de ses contemporains français auront été laissés sur le bas-côté. Mais on a aussi tendance à oublier que dès son premier album, Sister Iodine s’employait déjà à maltraiter son propre équilibre, à détruire ses propres idées et à faire table rase de ses propres propositions, parfois (et même souvent) au sein du même morceau. Ce qui fait aujourd’hui que ses disques ont tous aussi bien vieilli et sonnent toujours aussi neufs (et sont donc potentiellement aussi attrayants pour les jeunes oreilles assoiffées de frissons nouveaux).
Car en organisant son propre chaos, en ne concédant rien à son intention de départ tout en se nourrissant de différentes biles au fil des années, Sister Iodine n’aura pas seulement ouvert la voie à ces jeunes gens qui confondent dans le même geste power electronics, no wave et techno industrielle (de Low Jack à Powell donc, mais aussi plus largement ces labels de musique électronique traversés de formes noires, de The Trilogy Tapes à In Paradisum en passant par PAN) : il aura aussi créé une sorte de langage idiosyncratique, pour qui la recherche de matière sonore et de beauté formelle semble tout autant compter que l’énergie brute, d’une violence inouïe, déployée en concert.
Grâce à ces préceptes jusqu’au-boutistes dont il ne sera jamais débarrassé, Sister Iodine produit ainsi aujourd’hui une musique qu’on n’entend pour ainsi dire nulle part ailleurs, d’une audace et d’une jeunesse effarantes, et dont il ne serait pas totalement idiot de qualifier la portée et la vision d’avant-garde.